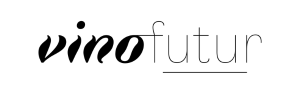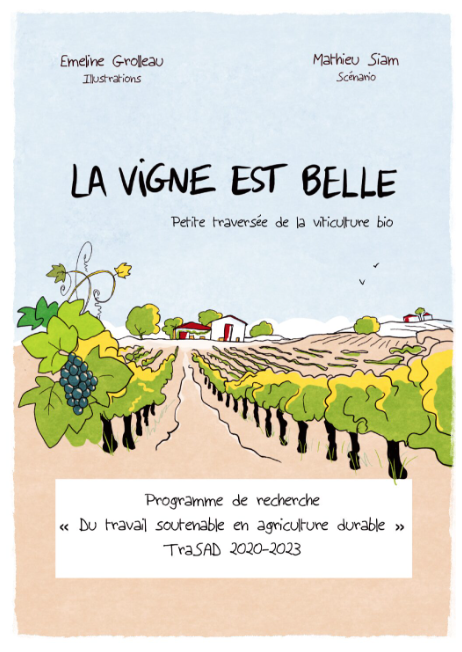Transition agro-écologique : quel impact sur les travailleurs de la vigne ?
Étude. Une étude de la MSA,portée par le centre de sociologie Emile Durkheim de l’université de Bordeaux se penche sur un angle mort de la transition agroécologique : l’impact sur les conditions de travail et de vie, en termes de santé (physique et mentale), de charge, etc pour celleux qui portent cette transition.
Pour une fois, on ne parle pas de la transition agro-écologique sous le seul angle des performance agronomiques ou économiques. Le programme TraSad (piloté par la MSA et mis en oeuvre par des sociologues) étudie les transformations du travail dans trois exploitations viticoles (en (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Grand Est) entamant une transition.
Ce sont donc les dimensions sociales et humaines – santé physique et santé mentale, notamment – qui sont observées, dans cette transition qui est parfois une « injonction » extérieure. « Le changement de pratiques agricoles s’accompagne en effet d’une transformation du rapport au métier agricole et au travail, qui peut engendrer des effets sur la santé, que ce soit à travers une modification de la charge de travail, ou bien par une modification des pénibilités proprement dites. » Ces transformations, selon comment elles sont vécues et appliquées, peuvent devenir des moteurs de la transition agro-écologique et de sa pérénisation… ou au contraire des freins.
Ce lien entre « conditions de travail » et « pérennité des nouvelles pratiques » ressort clairement de l’étude. Le programme montre aussi la disparité des « vécus » entre les différents itinéraires (AB, HVE, biodynamie), et notamment concernant la capacité d’adaptation et les « bénéfices perçus ». Le stress lié aux investissements nécessaires pour mener ces adaptations, souvent sans aide, est souligné. Mais globalement, les chercheurs ont observé qu’au-delà de la charge de travail, qui augmente, c’est aussi la dimension de ce travail qui change, avec l’émergence d’un nouveau « bien-être » lié à la fierté de ce qui est accompli, du sens et de l’autonomie retrouvés, etc.
La transition agro-écologique vécue différemment selon que l’on est salarié permanent ou saisonnier
Bilan : » La transition agro-écologique exige des ajustements coûteux et une adaptation continue, avec des implications majeures sur la viabilité économique des exploitations ».
Un point notable : la différence de dévu entre les salariés permanents à temps plein, « souvent plus enclin·es à adhérer à l’agriculture biologique en raison d’une autonomie accrue et d’une sensibilité renforcée aux enjeux environnementaux » et les salarié·es précaires, qui « expriment souvent des réticences, craignant une détérioration supplémentaire de leurs conditions de travail déjà fragiles. » Une des conclusions : “la transition agroécologique, bien que bénéfique pour l’environnement, génère une répartition inégale des coûts et des bénéfices non pas seulement entre les exploitations et les certifications, mais aussi parmi les acteurs et actrices du secteur agricole”.
🎧 Ce que l’agro-écologie fait au travail agricole : « Soit j’arrêtais tout, soit je continuais en bio » (France Culture)
Extrait de la newsletter Vinofutur d’avril 2025.
> Pour la recevoir, il suffit de s’abonner !
> Vous pouvez la lire en entier ici
Participez au vin de demain !
Une veille mensuelle ciblée sur les futurs du vin, les combats progressistes à mener, les innovations techniques ET politiques à tester… Chaque mois dans votre boîte mail. Il suffit de s’abonner.